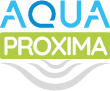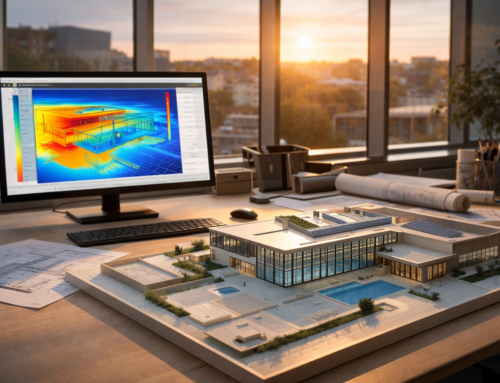Sport-Santé et Piscines publiques : l’urgence d’un positionnement clair pour les collectivités
Une priorité institutionnelle encore inaboutie sur le terrain
Depuis plusieurs années, le discours institutionnel en faveur du sport-santés’est considérablement renforcé.
Le Plan National de Santé Publique “Ma Santé 2022”, le Plan National Nutrition Santé, les politiques de lutte contre la sédentarité et les maladies chroniques, ou encore les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)convergent : l’activité physique est un déterminant majeur de santé publique.
Dans ce contexte, les centres aquatiques publics apparaissent comme des vecteurs puissants pour concrétiser cette ambition. Ils offrent des conditions optimales de pratique sécurisée, encadrée, intergénérationnelle, avec des effets bénéfiques prouvés sur la santé (faible impact articulaire, travail cardiovasculaire, rééducation, prévention des chutes, etc.).
Pourtant, sur le terrain, la déclinaison opérationnelle du sport-santé dans les piscines reste fragmentée, inégale, et rarement pilotée à l’échelle d’une stratégie territoriale.
➡️ Des initiatives nombreuses, mais un manque de structuration
Les collectivités locales investissent, les professionnels s’engagent, les associations innovent, mais l’absence de cadre stratégique partagénuit à la lisibilité et à l’impact durable des actions entreprises.
À défaut de doctrine claire, beaucoup de projets s’apparentent à des initiatives opportunistes, portées par la motivation de quelques agents ou élus, sans ancrage institutionnel fort, ni continuité dans le temps.
C’est là que se joue l’enjeu majeur : comment passer de la bonne intention à la véritable politique publique ?
Le flou autour du terme “sport-santé” : un frein à l’action
Le terme “sport-santé”, très mobilisé dans les discours, reste pourtant flou et hétérogène. Il n’existe ni définition réglementaire stabilisée, ni label officiel conférant une reconnaissance spécifique aux actions ou équipements.
L’OMS, de son côté, utilise le terme d’“activité physique” sans distinction entre les objectifs de prévention, de bien-être ou de soins. En France, cette ambiguïté s’est installée durablement, contribuant à une confusion dans les pratiques, les objectifs et les responsabilités.
Pour certains, le sport-santé relève de la prévention primaire (améliorer la condition physique globale). Pour d’autres, il s’agit de prévention secondaire ou tertiaire (post-rééducation, ALD, programmes d’activité physique adaptée – APA).
D’où une hétérogénéité des publics, des intervenants, des qualifications exigées, et des modèles économiques associés.
Trois piliers pour structurer une politique publique sport-santé
Pour dépasser cette confusion et faire des piscines des leviers territoriaux puissants au service de la santé, il est indispensable de structurer l’action publique autour de trois piliers fondamentaux :
1. Une intention claire
Il ne suffit pas de promouvoir “le sport-santé” ; encore faut-il formuler des objectifs précis :
- Quels publics cibles ? (seniors, personnes sédentaires, patients en ALD, jeunes inactifs…)
- Quels objectifs de santé ? (prévention des chutes, réduction du stress, réhabilitation cardiaque…)
- Quelle cohérence territoriale ? (articulation avec les maisons de santé, les réseaux de soins, les programmes locaux de santé…)
2. Des moyens identifiés
Une politique ne peut vivre sans ressources humaines, financières et partenariales. Cela implique :
- La formation spécifique des professionnels (MNS, éducateurs APA, coordinateurs sport-santé),
- La création de créneaux dédiés, avec un modèle économique clair (tarification adaptée, financements CPAM/ARS/Maison Sport Santé),
- La coordination interprofessionnelle : professionnels de santé, associations sportives, gestionnaires d’équipements, collectivités.
3. Un dispositif d’évaluation rigoureux
Trop d’actions sont conduites sans indicateurs de résultat ni suivi longitudinal. Or, pour démontrer l’intérêt du sport-santé, il faut :
- Définir des indicateurs de santé publique (IMC, stress perçu, VO2 max, etc.),
- Mettre en place un suivi des usagers, en lien avec les prescripteurs,
- Évaluer l’impact social et territorial du centre aquatique dans sa fonction préventive.
Centres aquatiques : des lieux de vie à transformer en outils de santé publique
Les centres aquatiques publics ne doivent plus être seulement des lieux de baignade ou de loisirs, mais devenir de véritables plates-formes territoriales de prévention et de promotion de la santé. Cela suppose un changement de paradigme.
De nombreuses études montrent que l’activité physique aquatique peut :
- Réduire le risque de maladies cardiovasculaires, d’obésité, de diabète,
- Améliorer la qualité de vie des personnes âgées,
- Réduire les douleurs articulaires et lombaires,
- Diminuer le stress et les troubles anxieux.
Mais pour atteindre ces résultats, les actions doivent être organisées, intégrées dans une offre de services lisible, avec un portage politique fort.
➡️ Comment AQUA PROXIMA accompagne les collectivités
Face à ce besoin de structuration, AQUA PROXIMA propose un accompagnement stratégique fondé sur trois leviers d’intervention :
1. Une lecture experte des référentiels nationaux
Nous analysons les textes et orientations actuelles (Ministère des Sports, ARS, CPAM, ONAPS) afin de positionner chaque projet local dans un cadre cohérent.
2. La définition d’un positionnement opérationnel clair
Nous aidons les collectivités à clarifier leurs ambitions, à structurer leur offre sport-santé et à identifier les ressources humaines et partenariales nécessaires.
3. L’élaboration de schémas directeurs intégrés
Notre méthode consiste à articuler les objectifs de santé publique aux ressources réelles du territoire (population, équipements, acteurs locaux), afin de maximiser l’impact des centres aquatiques.
Sortir de la logique opportuniste pour entrer dans une démarche stratégique
Les centres aquatiques publics ne sont pas des espaces neutres.
Ils peuvent devenir des outils de transformation territoriale en matière de santé publique — à condition d’être pensés, structurés et pilotés.
Il est temps de sortir de la logique de “créneaux disponibles” pour entrer dans une stratégie pilotée, interprofessionnelle, et évaluée. Il ne s’agit plus de faire du sport-santé “parce que c’est bien”, mais parce que c’est utile, structurant, et mesurable.
Savoir ce que l’on vise, c’est savoir comment investir durablement. Et c’est dans cette ambition que AQUA PROXIMA s’engage aux côtés des collectivités.
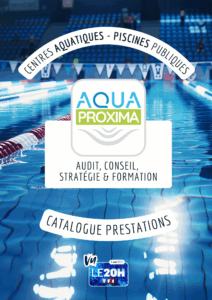
✅ Catalogue à télécharger en cliquant ICI.