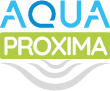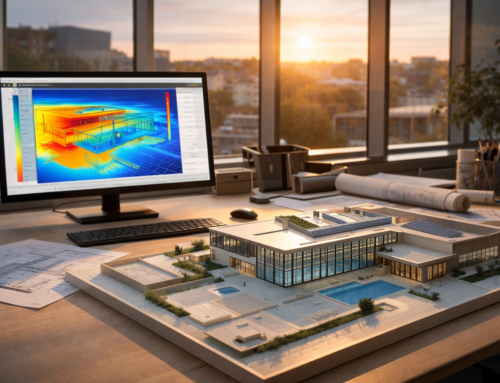Fidéliser les maîtres-nageurs dans les piscines publiques : 15 leviers stratégiques pour les collectivités
Le métier de maître-nageur sauveteur (MNS) constitue la clé de voûte de la sécurité et de l’attractivité des piscines publiques. Ces professionnels garantissent non seulement la prévention des noyades et la surveillance des bassins, mais participent également à la mission éducative, sportive et sociale des collectivités territoriales.
Pourtant, les gestionnaires font face à une crise de recrutement et de fidélisation sans précédent (Cour des comptes, 2023). Horaires atypiques, usure physique, manque de perspectives de carrière et déficit de reconnaissance fragilisent la stabilité des équipes.
Or, la fidélisation des MNS ne dépend pas uniquement des rémunérations, souvent contraintes dans la fonction publique territoriale : elle repose sur une stratégie globale de management, d’organisation et de qualité de vie au travail (QVT).
Voici 15 leviers d’action concrets et à fort impact, à la croisée des pratiques managériales modernes et des obligations réglementaires.
1. Recruter avec discernement : miser sur les valeurs, pas seulement les diplômes
Le recrutement est le premier maillon de la chaîne de fidélisation.
Dans de nombreuses collectivités, il repose encore trop souvent sur la possession du diplôme réglementaire (BEESAN, BPJEPS AAN, …). Si ces certifications garantissent la compétence technique, elles n’assurent pas l’adéquation culturelle et comportementale avec les valeurs du service public.
- Or, selon les recherches sur le management par compétences (CNFPT, 2021), les savoir-être représentent jusqu’à 60 % des causes d’intégration réussie dans un collectif.
Un recrutement axé uniquement sur les diplômes produit un effet pervers : des MNS techniquement compétents mais rapidement démotivés ou en décalage avec l’esprit d’équipe. À l’inverse, intégrer une évaluation comportementale(capacité d’adaptation, gestion du stress, rapport à l’autorité, relationnel) permet d’anticiper la réussite à long terme. Les collectivités doivent également penser à diversifier leurs méthodes de recrutement : entretien collectif, mises en situation, implication de l’équipe déjà en place.
Cette co-construction crée une dynamique positive et responsabilise chacun.
Enfin, définir des profils-types par activité (scolaire, aquasport, loisirs) permet d’ajuster le recrutement à la réalité du terrain. Dans un bassin fortement orienté vers les scolaires, les aptitudes pédagogiques seront déterminantes ; dans une structure de loisirs, l’animation et le sens de la relation client primeront.
En pratique :
- Utiliser une grille de recrutement intégrant compétences techniques et comportementales
- Associer un représentant de l’équipe en poste à l’entretien final
- Formaliser des fiches de poste différenciées selon les activités
Référence : CNFPT, Recruter par compétences (2021).
2. Construire des perspectives de carrière : sortir du cycle des CDD
L’un des premiers motifs de démotivation chez les maîtres-nageurs tient au sentiment d’être dans une impasse professionnelle.
Nombreux sont ceux qui, après quelques années, quittent la fonction publique pour rejoindre le privé ou changer totalement de voie.
- Pourtant, la fonction publique territoriale (FPT) offre de véritables perspectives de carrière, souvent méconnues. Entre les filières sportives, techniques, ou même administratives, les possibilités existent, à condition qu’elles soient expliquées et accompagnées.
Le décret n°2014-1526 rend obligatoire un entretien professionnel annuel pour chaque agent. Trop souvent perçu comme une simple formalité, il devrait être utilisé comme un outil stratégique de gestion des parcours. Identifier des opportunités de mobilité interne, proposer la préparation de concours (animateur territorial, éducateur territorial des APS), ou encore confier des responsabilités transversales (coordinateur hygiène/sécurité, tuteur de stagiaire) sont autant de leviers de fidélisation.
À l’échelle collective, il s’agit d’envoyer un message clair : le MNS n’est pas voué à rester toute sa carrière au bord du bassin, il peut évoluer vers l’encadrement, la formation, voire la direction d’équipements. Cet horizon professionnel constitue un puissant facteur de motivation et limite les départs prématurés.
En pratique :
- Tenir les entretiens professionnels de manière qualitative
- Identifier un référent RH dédié aux parcours des MNS
- Organiser des préparations internes aux concours et examens professionnels
Référence : Décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’entretien professionnel dans la FPT.
3. Investir dans la formation continue
Le recyclage quinquennal, obligatoire pour le maintien des diplômes, constitue une exigence minimale mais insuffisante.
Pour fidéliser les maîtres-nageurs, la formation doit être pensée comme un levier de valorisation et de progression professionnelle. Les agents qui se sentent accompagnés dans leur montée en compétences sont davantage enclins à rester dans leur poste.
- Plusieurs thématiques méritent une attention particulière :la gestion des conflits avec les usagers, l’actualisation des techniques de sauvetage, ou encore la médiation interculturelle, très présente dans certains bassins.
La formation au management pour les MNS expérimentés est également une piste, car elle leur ouvre des perspectives d’évolution hiérarchique. L’IGAS (2019) souligne que les collectivités qui investissent dans la prévention des noyades via la formation obtiennent de meilleurs résultats de fidélisation.
- De nombreux organismes spécialisés, comme AQUAPROXIMA ou PISCINE FORMATION, proposent des modules adaptés : posture professionnelle, cohésion d’équipe, accueil de publics sensibles.
Ces formations peuvent être organisées en intra-collectivité, limitant les coûts logistiques et renforçant la dynamique d’équipe.
En pratique :
- Planifier chaque année un budget formation spécifique pour les MNS
- Identifier un « référent formation » au sein du service
- Mettre en place des parcours certifiants internes (ex : formateur SST)
Référence : IGAS, Rapport sur la prévention des noyades (2019).
4. Accorder autonomie et responsabilités
Les MNS expriment régulièrement une frustration liée à un cadre de travail trop rigide. Leur rôle est souvent réduit à une surveillance passive, alors qu’ils aspirent à être des acteurs responsables. Selon Herzberg (1959) et sa théorie des deux facteurs, l’autonomie et la reconnaissance sont de puissants moteurs de motivation, supérieurs aux aspects purement financiers.
Concrètement, confier des responsabilités progressives permet de stimuler l’engagement. Il peut s’agir de gérer un stock de matériel, de concevoir un cycle d’animations, ou de participer au choix du matériel pédagogique.
- L’autonomie n’implique pas l’absence de contrôle, mais une confiance donnée dans un cadre structuré. Elle renforce le sentiment d’appartenance et valorise les compétences.
Certaines collectivités expérimentent même des modèles de « mini-projets » confiés aux MNS, tels que la création d’événements aquatiques ponctuels ou la mise en place de dispositifs pédagogiques spécifiques. Ces initiatives favorisent l’innovation, réduisent la lassitude et augmentent la satisfaction professionnelle.
En pratique :
Confier des responsabilités concrètes, adaptées à l’expérience de l’agent
- Instaurer des bilans réguliers pour valoriser les réussites
- Créer un système de projets courts confiés aux équipes
Référence : Herzberg, The Motivation to Work (1959).
5. Valoriser et reconnaître les réussites
La reconnaissance est un facteur déterminant de fidélisation.
Pourtant, dans la fonction publique, elle est souvent négligée au profit d’un discours centré sur les contraintes. Or, de nombreuses études (OCDE, 2022) montrent que la reconnaissance symbolique est aussi efficace que la reconnaissance financière dans la motivation des agents.
- Reconnaître un agent peut prendre des formes simples : un remerciement officiel, une valorisation en réunion, un article dans le bulletin municipal.
Certaines collectivités mettent en place des dispositifs plus structurés, comme l’ »agent du mois » affiché dans l’équipement. D’autres organisent des challenges internes ou des participations à des concours régionaux.
La reconnaissance doit être sincère, régulière et équitable. Elle ne doit pas se limiter à récompenser les « meilleurs », mais valoriser les progrès, la gestion de situations délicates, ou l’investissement invisible mais réel.
En pratique :
- Intégrer un point « valorisation des réussites » à chaque réunion
- Mettre en place un tableau d’affichage des initiatives réussies
- Impliquer les usagers dans la reconnaissance (boîte à compliments)
Référence : OCDE, Rapport sur la reconnaissance au travail (2022).
6. Améliorer la qualité de vie au travail (QVT)
La fidélisation passe par une qualité de vie au travail digne et adaptée.
Les conditions matérielles et humaines jouent un rôle déterminant dans l’engagement. L’accord-cadre du 22 octobre 2013 sur la QVT dans la fonction publique rappelle l’importance de la prévention des risques psychosociaux et de la qualité des environnements de travail.
- Dans le cas des piscines, cela se traduit par exemple, par la propreté et l’équipement des locaux de pause, l’anticipation des plannings, la mise à disposition d’équipements de protection adaptés.
La concertation autour des plannings est essentielle : les agents doivent être consultés pour éviter des contraintes inutiles.
La QVT ne concerne pas uniquement les conditions matérielles, mais aussi la gestion du collectif : lutte contre les incivilités, médiation entre services, prévention du stress. Une collectivité qui agit sur ces aspects réduit considérablement l’absentéisme et les départs.
En pratique :
- Créer des espaces de repos confortables et adaptés
- Planifier les plannings à l’avance, en intégrant les contraintes des agents
- Mettre en place un comité QVT incluant des représentants des MNS
Référence : Accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la QVT.
7. Associer les MNS aux décisions : gouvernance partagée et stabilité des équipes
Les décisions prises par une collectivité – qu’il s’agisse de l’organisation des lignes d’eau, du planning d’occupation des bassins ou du règlement intérieur – ont un impact direct sur le quotidien des maîtres-nageurs.
Trop souvent, ces décisions sont perçues comme verticales et éloignées du terrain, ce qui alimente frustration et désengagement.
- Impliquer les MNS dans les processus décisionnels ne signifie pas leur donner un pouvoir hiérarchique, mais reconnaître leur expertise et favoriser une logique de co-construction. La littérature en management participatif (Laloux, Reinventing Organizations, 2016) souligne que l’implication des agents dans les décisions renforce leur sentiment d’appartenance et réduit le turnover.
Les modalités peuvent être simples :consultation régulière lors des réunions de service, comités spécifiques pour discuter des questions pédagogiques ou techniques, enquêtes internes sur la satisfaction des agents face aux décisions.
Cette démarche ne nécessite pas de coûts financiers mais demande une volonté politique et managériale forte.
En pratique :
- Créer un comité interne de concertation incluant des représentants des MNS
- Organiser des ateliers de co-design pour les nouveaux règlements ou les projets pédagogiques
- Valoriser la contribution des MNS en communiquant sur leur rôle dans la décision finale
Référence : Laloux, F. (2016), Reinventing Organizations.
8. Créer un environnement de confiance : communication et bienveillance
La confiance est un pilier essentiel du management.
Dans les piscines publiques, elle est pourtant souvent fragilisée par une communication déficiente, trop verticale ou marquée par l’absence de retours constructifs.
Or, sans confiance, il est impossible de fidéliser des équipes exposées à des responsabilités vitales comme la sécurité des usagers.
La circulaire de la DGAFP (10 avril 2017) insiste sur la nécessité de renforcer le dialogue social dans la fonction publique.
- Concrètement, cela passe par des réunions d’équipe régulières, des outils de communication adaptés (cahier de liaison, plateformes numériques internes, groupes WhatsApp professionnels), et une culture du droit à l’erreur.
La bienveillance managériale joue aussi un rôle : un agent qui se sent écouté et soutenu sera plus engagé. Des pratiques simples comme le feedback positif, la reconnaissance des efforts même en cas d’échec, ou la médiation en cas de conflits internes contribuent à instaurer un climat de confiance durable.
En pratique :
- Instaurer une réunion mensuelle obligatoire dédiée aux échanges constructifs
- Mettre en place un cahier de liaison numérique pour fluidifier la transmission des consignes
- Former les encadrants à la communication bienveillante et au feedback positif
Référence : DGAFP, Circulaire sur le dialogue social (2017).
9. Développer des avantages sociaux attractifs
Les salaires des maîtres-nageurs dans la fonction publique territoriale sont encadrés par les grilles statutaires et donc peu négociables.
✔️ Pour autant, les collectivités disposent de marges de manœuvre par le biais d’avantages sociaux, souvent sous-estimés. Ces « à-côtés » améliorent l’attractivité et fidélisent les agents.
La participation employeur à la mutuelle santé, l’octroi de tickets-restaurant, la gratuité des activités aquatiques pour la famille ou encore l’accès à une cantine municipale sont des leviers efficaces.
- Ces avantages, bien que modestes financièrement, créent un attachement concret à l’employeur.
Dans certaines collectivités, la mise en place de dispositifs innovants (prêt de matériel sportif, subventions pour les activités culturelles, prise en charge partielle des transports) contribue également à fidéliser. Ces mesures, inscrites dans une politique RH cohérente, sont valorisées lors du recrutement et permettent de rivaliser avec le secteur privé.
En pratique :
- Réaliser un benchmark des avantages sociaux dans les communes voisines
- Mettre en avant ces avantages dans les annonces de recrutement
- Créer un guide interne des avantages pour informer et valoriser l’action de la collectivité
Référence : Centre de Gestion de la FPT (2022), Avantages sociaux et fidélisation des agents territoriaux.
10. Préserver l’équilibre vie pro / vie perso
L’un des défis majeurs du métier de maître-nageur réside dans les horaires atypiques : travail le soir, les week-ends, jours fériés, et souvent en coupure.
Ce rythme entraîne un déséquilibre important entre vie professionnelle et vie personnelle, à l’origine d’un fort turnover.
La réglementation impose un minimum de repos quotidien (Article L.3121-44 du Code du travail : 11 heures consécutives). Mais au-delà des obligations légales, il est possible d’aller plus loin.
- La planification mensuelle des plannings, la limitation des coupures et l’annualisation du temps de travail sont des leviers efficaces. Certaines collectivités mettent en place des cycles stables, permettant aux agents de prévoir leur vie personnelle et de réduire le stress organisationnel.
De plus, l’équilibre vie pro/vie perso n’est pas uniquement une question d’horaires. Il implique aussi une culture managériale qui respecte les temps de repos et qui évite les sollicitations hors service. L’OCDE (2021) a montré que la conciliation entre vie professionnelle et personnelle constitue un facteur clé de rétention dans le secteur public.
En pratique :
- Établir des plannings sur un mois glissant au minimum
- Réduire les coupures en regroupant les heures de travail
- Prévoir des temps de repos obligatoires entre deux séquences de travail
Référence : Article L.3121-44 du Code du travail.
11. Développer une culture organisationnelle positive
La fidélisation des MNS ne dépend pas seulement des conditions individuelles de travail, mais aussi du climat collectif.
Une piscine publique n’est pas uniquement un service, c’est un lieu de vie sociale où se croisent des agents techniques, d’accueil et de surveillance. Construire une culture organisationnelle positive permet de fédérer et de donner envie de rester.
Cela passe par l’élaboration d’une charte d’équipe qui définit les valeurs communes, par l’intégration systématique des nouveaux arrivants grâce à un tuteur, et par la mise en place de moments de convivialité.
- Les travaux de Schein (2010) sur la culture organisationnelle montrent que des valeurs partagées réduisent les tensions inter-services et améliorent la coopération.
Les collectivités qui développent cette culture constatent une meilleure fluidité de la communication et une diminution des conflits internes. Cela nécessite un engagement managérial fort, mais pas nécessairement des moyens financiers importants.
En pratique :
- Rédiger une charte d’équipe en associant tous les agents
- Nommer un tuteur pour chaque nouveau MNS
- Organiser des débriefs inter-services réguliers pour fluidifier la communication
Référence : Schein, E. (2010), Organizational Culture and Leadership.
12. Redonner du sens aux missions
Le maître-nageur n’est pas un simple surveillant de bassin. Il est un acteur de santé publique, un éducateur sportif et un médiateur social.
Redonner du sens à ses missions contribue à renforcer son engagement et sa fierté professionnelle.
Le rapport IGAS (2019) souligne l’importance de la prévention des noyades et de l’apprentissage de la natation en milieu scolaire. En impliquant les MNS dans ces missions, les collectivités valorisent leur rôle sociétal.
- La création de partenariats avec les écoles, l’organisation de journées de sensibilisation à la sécurité aquatique, ou encore la mise en avant des impacts sociaux des activités aquatiques renforcent le sentiment d’utilité.
Communiquer en interne et en externe sur ces missions est tout aussi important : articles dans le bulletin municipal, posts sur les réseaux sociaux, témoignages d’usagers. Cette valorisation permet de sortir de l’image réductrice du « surveillant » et de donner une véritable dimension éducative et citoyenne au métier.
En pratique :
- Développer des fiches « impact social » pour chaque activité
- Créer des partenariats avec les établissements scolaires et associations
- Valoriser le rôle des MNS dans les médias municipaux
Référence : IGAS, Rapport sur la prévention des noyades (2019).
13. Instaurer des rituels d’équipe
Les rituels jouent un rôle structurant dans le management des équipes. Ils créent un cadre, rassurent, et favorisent la cohésion.
Dans les piscines publiques, où le rythme est intense et les tensions fréquentes, instaurer des rituels simples mais réguliers peut améliorer considérablement la fidélisation.
- Il peut s’agir de briefings quotidiens avant l’ouverture pour rappeler les points de vigilance, de débriefs hebdomadaires pour analyser les incidents et valoriser les réussites, ou encore de repas d’équipe trimestriels pour renforcer la convivialité.
Ces pratiques favorisent la communication et réduisent les malentendus.
Les recherches en psychologie du travail (Hackman & Oldham, 1980) montrent que les rituels renforcent le sentiment d’appartenance et donnent de la cohérence à l’action collective. Pour les MNS, cela contribue à leur stabilité émotionnelle et réduit l’isolement professionnel.
En pratique :
- Instaurer un briefing de 10 minutes chaque matin
- Organiser un débrief hebdomadaire formel
- Prévoir un moment convivial collectif chaque trimestre
Référence : Hackman, J.R. & Oldham, G.R. (1980), Work Redesign.
14. Préserver la santé physique et mentale
Le métier de MNS est exigeant : station debout prolongée, exposition à l’humidité et au bruit, gestion des incivilités, interventions parfois traumatisantes lors d’accidents.
Préserver la santé physique et mentale des agents est donc un impératif pour les fidéliser.
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé rappelle l’importance de la prévention des risques professionnels.
- Dans les piscines, cela peut se traduire par un suivi médical renforcé, l’accès à des soins de récupération (ostéopathie, cryothérapie, kinésithérapie), ou des formations à la gestion émotionnelle et au self-control.
Certaines collectivités innovent en mettant à disposition des espaces de récupération (salles de repos équipées) ou en proposant des ateliers de relaxation. Ces dispositifs, bien qu’inhabituels dans la fonction publique, contribuent à la longévité professionnelle des agents.
En pratique :
- Organiser une visite médicale annuelle renforcée
- Négocier des partenariats locaux avec des kinésithérapeutes ou ostéopathes
- Proposer des formations en gestion du stress et des émotions
Référence : Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016.
15. Accompagner les moments difficiles
La vie professionnelle des MNS peut être marquée par des événements difficiles : accident grave, noyade, conflit avec un usager ou un collègue, procédure disciplinaire.
Ces situations, si elles sont mal accompagnées, conduisent souvent à des ruptures définitives avec la collectivité.
Un accompagnement humain et psychologique est donc indispensable. Cela peut prendre la forme d’un dispositif d’écoute interne (référent RH formé), d’un soutien psychologique externe (psychologue du travail, cellule d’urgence) ou d’un accompagnement personnalisé lors du retour après un événement traumatisant.
Les collectivités qui mettent en place de tels dispositifs constatent une plus grande loyauté des agents et une meilleure résilience collective. La gestion humaine des moments difficiles ne doit pas être perçue comme une option mais comme un investissement stratégique dans la stabilité des équipes.
En pratique :
- Former un référent RH à la gestion post-événement critique
- Mettre en place un partenariat avec un psychologue spécialisé
- Prévoir un entretien de reprise systématique après un arrêt lié à un événement grave
Référence : INRS, Accompagnement psychologique au travail (2020).
✅ Conclusion : fidéliser pour sécuriser et pérenniser les services aquatiques
Fidéliser les maîtres-nageurs sauveteurs ne consiste pas uniquement à améliorer leurs conditions financières – bien que la question des rémunérations demeure cruciale à l’échelle nationale.
Cela implique avant tout une vision managériale globale, intégrant le recrutement, la formation, l’organisation du travail, la reconnaissance, la santé et la communication.
Les 15 leviers présentés démontrent qu’il est possible d’agir sans moyens financiers exorbitants, mais avec une volonté forte de transformer les pratiques. Dans un contexte où chaque agent compte, la fidélisation devient une stratégie centrale pour :
- garantir la sécurité des usagers
- préserver la qualité de service
- réduire le coût du turnover
- renforcer l’image de la collectivité
Un diagnostic managérial approfondi, tel que proposé par AQUA PROXIMA, constitue un outil précieux pour analyser les points forts et les axes d’amélioration de chaque structure.
✅ Et si on faisait le point ensemble sur votre piscine ?
✔️ Vous vous retrouvez dans ce que vous venez de lire ?
✔️ Vous vous demandez comment améliorer concrètement le fonctionnement de votre piscine publique, réduire les surcoûts, sécuriser vos équipes ou faire évoluer votre offre de services… mais sans vraiment savoir par où commencer ?
✔️ Vous aimeriez pouvoir confronter vos idées, vos contraintes budgétaires et vos enjeux politiques avec un regard extérieur, expérimenté et neutre ?
Pourquoi rester seul avec ces questions alors qu’un simple échange peut déjà vous éclairer sur les priorités, les risques et les leviers d’action pour votre équipement ?
📍 Si vous souhaitez être rappelé, obtenir des renseignements précis ou simplement vérifier que votre situation mérite (ou non) un accompagnement, il vous suffit de remplir le formulaire de contact à cette adresse 👉 https://www.aquaproxima.fr/contact/
✅ Laissez-nous vos coordonnées et quelques mots sur votre centre aquatique : nous reviendrons vers vous rapidement pour un premier échange sans engagement.